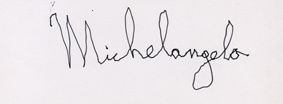C'est le terminus d'une semaine de folie... et je n'étais pas tout seul à être ivre de bonheur et de fatigue ! 15 000 joueurs, 125 000 personnes sur le salon en train de jouer à
tous les jeux du monde, de jour comme de nuit, dans une ambiance de folie sans aucun incident... On prouve à Cannes que les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes,
les nations (50 pays représentés), les religions, les différences, ne sont pas des obstacles mais peuvent, bien au contraire, être un ferment d'émulation, un enrichissement, une façon de
mieux se comprendre !
Comme une tour de Babel, un phare dans la nuit des vieux démons, nous avons éclairé le monde d'un faisceau lumineux d'humanité, d'un bonheur simple et immédiat. Dans le dépassement de
soi, l'affrontement aux autres, le respect des règles et la dimension ludique sont chargés de ce lien social possible et souhaîtable que le monde politique cherche sans jamais trouver. Les
adieux déchirants sonnent l'heure des retrouvailles... A l'an prochain, déjà !
Le texte que vous pouvez lire a été composé en 2003... Il est extrait d'un projet avorté mais il garde toute son actualité concernant le Festival des Jeux de cannes. C'est la 16ème
"histoires vraies" du blog. Une page de mon passé au sein de cette structure !
Garry Kasparov, parmi tous les joueurs que j'ai rencontrés, est celui qui m'a le plus impressionné tant par la brutalité absolue qu'il dégage que par cette obstination qui se cache au fond de lui
et l'empêche de s'avouer vaincu quelles que soient les situations. Au Championnat du Monde en parties semi rapides organisé avec la Fédération Française d'Echecs et le club de Cannes de Damir
Levacic dans le cadre du Festival International des Jeux 2001, la finale se déroulait sur le plateau du Palais des Festivals et se présentait comme l'affrontement logique entre la star qui avait
renoué avec une compétition officielle de la FIDE, la fédération internationale, et un de ses dauphins naturels, le Russe Evgeny Bareev qui culminait à 2704 points Elo dans le classement des
joueurs et rendait 145 points à "l'ogre de Bakou".
Kasparov est une légende et continue, dans une longévité exceptionnelle, à régner sur les 64 cases, défiant le temps et l'usure des sommets vertigineux sur lesquels il campe en tsar
indéboulonnable. Né en 1963, il devient le plus jeune Champion du Monde de tous les temps en 1985, à l'âge de 22 ans, endossant par la même occasion, le statut de leader de l'opposition et de la
révolte contre l'establishment russe qui imprimait sa main de fer sur l'univers de ce jeu, institution en Union Soviétique et source d'accession aux plus hautes sphères de l'Etat garantissant les
honneurs et privilèges attachés à ceux qui le servent et lui rendent grâce.
Sa rivalité avec Anatoli Ievguenievitch Karpov a marqué l'histoire des échecs de la deuxième partie de ce XXème siècle de quelques pages d'or. Karpov, de douze ans plus âgé, élève de Botvinnik,
triple Champion du Monde qui lui permettra d'obtenir ses premiers succès dès l'âge de 15 ans, devient l'idole de l'Union Soviétique après la retraite de l'Américain Bobby Fischer et sa victoire
aux Philippines, à Baguio en 1978, contre le dissident Victor Korchnoï, au bout d'un suspense de trente deux parties acharnées, parsemées d'incidents innombrables déclenchés alternativement par
les deux joueurs qui luttaient, non seulement pour leur suprématie, mais aussi pour la victoire politique de leur camp. Des coups fourrés, des changements de positions, des médiums invités à la
grand-messe, des exigences sur les meubles et les lumières, les attitudes des arbitres, tout fut prétexte à un duel acharné opposant les deux clans et se soldant par un combat planétaire entre
les forces de l'establishment et celles de la dissidence. Kasparov n'avait que 15 ans à l'époque du sacre de Karpov et il avait analysé ses parties des nuits entières, jusqu’à voir l’aube se
lever sur des rêves de conquête d’un titre mondial qui lui permettrait de régner sur le monde des échecs, son ambition et la certitude d’un destin planétaire n’ayant pas de limites. Déjà proche
de la perfection, son jeu s'était affirmé entre la science tactique, l'originalité de ses stratégies, une approche purement animale et ce formidable instinct de tueur qui allaient devenir le
sceau de son talent.
C'est en 1984 que leur duel annoncé allait se concrétiser, dans un premier round qui dura quarante-huit parties d'un championnat marathon interrompu par le président de la Fédération en
dépit de toute équité, pour des raisons fallacieuses qui tendaient à protéger le tenant du titre, duel fratricide des deux produits les plus parfaits de l'école russe des échecs, match sans
vainqueur, débridé, sans foi ni loi, que Karpov menait mais où Kasparov semblait en mesure de pouvoir revenir. Ce n'était que partie remise pour celui qui avait gagné un surnom à défaut du
championnat, "l'ogre de Bakou" qui, en 1985, terrassait Karpov et l'Union Soviétique en pleine décomposition pour ne plus lâcher prise et sceller son nom au destin des échecs de la fin du
millénaire, devenant la plus grande légende vivante, rejoignant au Panthéon des grands hommes, ceux qui marquent l'histoire de leur empreinte et transforment la réalité.
De cette première rencontre avec lui, je me souviens, dans les coulisses du Palais des Festivals, juste avant la finale que je devais présenter avec Damir devant 1500 personnes, de son regard
noir, de ses épaules qu'il rentrait, sa tête basse et l'authentique violence qui émanait de lui, cette haine qui jaillissait en flots tumultueux, n'épargnant personne, de sa capacité à se
concentrer en tournant comme un fauve en cage, et de l'explosion quand nous sommes entrés sur scène, sous les sunlights et que plus rien ne comptait que ce titre de Champion du Monde en parties
semi rapides qu'il voulait reconquérir pour son come-back dans les compétitions officielles de la Fédération Internationale. Celle-ci était dirigée par son ennemi, Kirsan Ilyumjinov, président de
la République autonome de Kalmoukie, petit Etat de la Fédération de Russie, peuplée de descendants des Torgouts, guerriers mongols qui régnèrent sur l'Asie Centrale et campent désormais sur
une terre aux réserves de pétrole enfouies sous les sabots de leurs chevaux et dont la production de caviar est une des ressources naturelles génératrices de revenus substantiels. Ilyumjinov
avait réussi une OPA, au congrès de Paris en 1995, en se faisant élire président de la Fédération Internationale des Echecs, deuxième fédération sportive au monde après le football, à l'époque
sous la coupe d'un personnage trouble aux relents sulfureux, le Philippin Campomanes celui-là même qui avait organisé le match de 1984 entre Karpov, le Champion du Monde en titre et son
challenger Garry Kasparov. Depuis, ce chef d'Etat de la seule République bouddhiste d'Europe, sorti de l'HEC russe, qui avait surfé sur la vague du libéralisme embrasant la Russie pour accumuler
une fortune colossale, ami de Wladimir Poutine, était devenu le bailleur de fonds d'un sport échiquéen surmédiatisé mais qui n'arrivait pas à drainer les moyens financiers nécessaires à son
développement.
J'avais rencontré le Président Ilyumjinov à Istanbul, pendant les olympiades d'échecs qu'il sponsorisait avec largesse, dans la période de préparation du Championnat du Monde et je le
revoyais, avec ses lunettes noires, jeune, visage de Yakusa égaré dans un costard noir qui lui cintrait une taille fine et des muscles d'acier, tout droit sorti d'un film de Kitano, ses deux
porte-flingues à ses côtés, le regard absent ne s'animant qu'à l'annonce que Kasparov allait réintégrer le giron des compétitions internationales et serait présent pour cette coupe du monde
organisée à Cannes sous son égide, après plus de cinq ans de brouilles et sa tentative avortée de créer une fédération concurrente.
Le champion n'a pas eu besoin de départage, ces parties complémentaires que l’on doit jouer en cas d'égalité au score, tant il s'était programmé pour vaincre. Pour la finale, les deux
compétiteurs trônaient sur une estrade, séparés par une table qui supportait un échiquier et la pendule électronique où s'égrenaient les vingt minutes de base octroyées à chacun, auxquelles
s'ajoutaient dix secondes par coup joué pour l'emballage final. Des caméras reprenaient leur visage et fixaient leurs attitudes sur l'écran gigantesque où avaient été projetés les plus grands
films de l'histoire du cinéma. Entre les images des joueurs, un échiquier géant télécommandé par informatique permettait de suivre la partie en direct pendant que Damir Levacic, en cabine,
commentait les coups relayé par des écouteurs HF, expliquant les positions et les choix stratégiques, faisant participer le spectateur au suspense de cette finale arbitrée par un Canadien,
Stephen Boyd, au flegme tout britannique. Dans la première manche, Kasparov avait tiré les noirs et résistait dans une partie anglaise où les pions C4-C5 maîtrisent l'espace central, donnant une
force aux blancs et instaurant un avantage positionnel microscopique mais durable, une approche du jeu exploitable par un jongleur du type de l'opportuniste Bareev, grand spécialiste de cette
ouverture. C'est un style de jeu karpovien que Bareev développait, un Karpov auquel il ressemble physiquement, même maigreur, même taille, yeux clairs, cheveux blonds sur le côté, attitude
nonchalante dissimulant une volonté de fer. Au bout d'un combat acharné, Garry arrachait la parité, un bon résultat qui le positionnait en force pour la revanche où il récupérait les blancs et
l'avantage de l'ouverture, produit d'un combat où rien n'avait été cédé, où les défenses avait pris le pas sur les attaques dans une véritable guerre de tranchées où chaque interstice dans les
positions donnait lieu à un affrontement pied à pied menant vers une neutralisation finale.
J'étais sur scène avec l'arbitre de plateau, l'oreillette me permettant de suivre les commentaires enflammés de Damir, micro à la main, prêt à intervenir. Avec les blancs, Garry ouvre d'un
E4 sur lequel Bareev opte pour le E6 de la défense française. Un flottement, une rumeur incrédule est montée de la salle stupéfaite par ce traitement de l'attaque d'ouverture, Kasparov allant
provoquer son adversaire sur son terrain de prédilection. C'est dans le style de Karpov que le champion venait chercher cette victoire, une confrontation inédite par échiquier interposé avec son
légendaire adversaire dont Bareev était le meilleur exégète. Kasparov savait que le départage lui serait favorable tant sa capacité d'improvisation et sa rapidité d'exécution étaient légendaires,
pourtant il impulsait une pression formidable, prenant tous les risques, usant de ses coups de boutoir qui l'avaient rendu célèbre, s'engouffrant par une brèche infime pour ne
plus lâcher sa proie, le talonnant jusqu'à la perte du temps, des repères et du sang-froid, dans un abandon final devant la trotteuse de la pendule. C'était la victoire d'un stratège au
zénith de ses moyens, à l'optimum de ses capacités sur un guerrier qui n’avait jamais abdiqué.
Kasparov avait le regard fixe et haineux, le corps ramassé et noueux, les veines de ses mains d'homme de la terre d'Azerbaïdjan couvertes de poils noirs, palpitaient pendant qu'il les
frottait l'une contre l'autre. Il semblait prêt à jaillir de son siège, comme si cette position assise en ce final à couteaux tirés lui devenait insupportable, comme si son énergie ne lui
permettait plus de contrôler les mouvements sporadiques qui ne se calmaient que quand sa main saisissait une pièce et la déplaçait sur l'échiquier, plongeant toujours plus son challenger dans le
doute et le désarroi, parachevant sa victoire d'une maîtrise du temps qui laissa pantois l'ensemble des spécialistes garnissant les fauteuils de la salle, médusés par ce combat de légende.
C'est à ce moment précis, en le voyant sous mes yeux, dans une proximité qui me permettait de ressentir physiquement ses réactions, que j'ai perçu à quel point les champions hors norme échappent
aux codes en vigueur chez les communs des mortels. Dans ce jeu, il n'y a, au monde, qu’une poignée d'hommes à être capables de transgresser les règles, de les faire évoluer, une minorité seule a
le talent de l'inconscience et peut atteindre à la grâce sublime de ceux que l'aile du génie effleure. Je me suis demandé si mon ami Massoud, qui avait été formé dans le même moule, qui
avait côtoyé tous ces grands champions, qui avait été nourri des sources de cet enseignement, aurait trouvé sa place sur l'échiquier de la vie si le conflit absurde dans lequel les soviétiques
s'étaient enlisés en Afghanistan ne l'avait irrémédiablement chassé dans les limbes du jeu, dans un hors case qui avait ruiné les chemins de sa destinée et conduit vers la solitude et l'abandon.
Quelques heures après cette victoire, Garry me fit porter un pli par son secrétaire particulier, sparring-partner et homme de confiance qui le suivait comme son ombre. Il m'invitait à souper avec
lui à La Belle Otero, un restaurant panoramique qui dominait la baie de Cannes au septième étage de l'hôtel Carlton et dont le chef avait deux étoiles. Autour du maître et de ses deux
assistants de jeu, le président de la Fédération Française et Damir Levacic m'attendaient en dégustant un verre d’un Grand Cru classé qui trônait sur la table miroitante d'argenterie et jetait
des éclairs sanguins sur la nappe immaculée. Kasparov était en train de commenter les noms de ses rivaux, à la recherche d'un successeur potentiel qui saurait l'abattre et récupérer le sceptre
qu'il venait de reconquérir. D'Annand, l'Indien trop inconstant et fragile à Kramnik, le Russe manquant d'imagination selon lui, aucun de ses dauphins naturels ne lui semblaient posséder la
capacité de le battre sur le temps, et dans la suffisance et la morgue de sa victoire, Garry le Magnifique plastronnait, dégustant à petites lampées son nectar, déclamant des sentences à la cour
qui l'entourait et l'écoutait religieusement. Tout au plus la nouvelle génération à l'image d'Etienne Bacrot, le surdoué français qui avait porté le titre de plus jeune grand maître de
l'histoire des échecs ou le talentueux Ponomariov, une nouvelle pépite de l'école russe, trouvaient-ils grâce à ses yeux et, bien que trop tendre pour l'heure, lui donnaient l'impression de
prendre date avec le futur. En se projetant ainsi dans l'avenir, "l'ogre de Bakou" niait le présent et en gommant une génération, inconsciemment, perpétuait son règne et s'octroyait un peu de ce
temps qui lui filait entre les doigts, sonnant l'heure d'une retraite inéluctable et la victoire des années qui s'écoulaient sur sa volonté de fer. En aparté, Damir me confia qu’il
l'avait vu recevoir de Moscou des fax qui analysaient les parties de l'Ambler Tornement qui se déroulait, avec quelques-uns uns de ses principaux rivaux, à Monaco, trente kilomètres plus loin.
Garry, derrière le talent brut, est aussi une bête de travail et un monstre d'organisation, utilisant les moyens techniques les plus sophistiqués, recrutant les meilleurs assistants et les
stratèges les plus performants afin de les mettre à son service et de les utiliser au profit de la construction d'un mythe qu'il s'attelle à bâtir tous les jours et qui porte son nom en
lettres d'or.
A table, confortablement installés, il nous régala de quelques anecdotes sur les innombrables tournois qui l'avaient entraîné aux quatre coins du monde, d'un avion à l'autre, d'un hôtel à un lit
de hasard, avec toujours cette réputation de tueur qui le précédait et dont il tirait une réelle jouissance, se repaissant du visage apeuré de ses adversaires, des rictus nerveux au moment de la
mise à mort, de la sueur et du goût de sang qui concluaient les mouvements compulsifs des mains sur l'échiquier, de cette dualité d'un monde où le noir et le blanc des pièces de bois bornent
l'horizon d'une frontière infranchissable. L'histoire des coqs nous fit rire aux larmes tant sa façon de la raconter, son sabir mêlant un fond de russe sur des pans d'anglais saupoudrés de zestes
de français, espagnol et italien, épiçait cette farce d'un KGB qui, en 1990, à Lyon dans la revanche du championnat du monde qui l'opposait à son éternel rival, Anatoly Karpov, avait payé les
paysans qui habitaient autour de sa résidence pour que des dizaines de coqs chantent dès les premières lueurs de l'aube et l'empêchent de dormir.
Je dégustais un foie gras poêlé en chapelure d'oignon qui fondait dans la bouche, le vin coulait comme un ruisseau de vie dans notre gorge et lui, plus que jamais certain de sa toute puissance,
nous affirmait qu'il règnerait encore dix ans sur l'homme et que Deep Blue, l'ordinateur diabolique, ne l'avait battu que sur l'abandon de son physique et la trahison de son corps. Il resterait
pour l'éternité le 13ème Champion du Monde, celui qui, au 13ème coup de la 13ème partie avait proposé une innovation théorique qui avait stupéfié tous les commentateurs et
analystes de ce jeu, celui qui ne pouvait dormir dans un hôtel qu'à la chambre 13 et ne sortait jamais sans ce chiffre 13 caché dans une de ses poches, sur un porte-clefs dont il ne se séparait
jamais. Au fond, sa vie réelle n'avait que peu d'importance devant la richesse de sa vie rêvée et il n'était pas indispensable de savoir que ce symbole de la révolte, cet étendard de
l'anticonformisme avait été inscrit aux Jeunesses Communistes avant de rejoindre le camp de Gorbatchev sous Brejnev, puis d'être Eltsinien sous Gorby, de prôner Lebed à la disparition de Eltsine
et de chercher sa place sous Poutine, toujours ailleurs, jamais présent, la tête dans les nuages à côtoyer des dieux désincarnés et à se perdre dans les arcanes des stratégies et des recherches
d'un geste impossible et d'une perfection inhumaine.
C’était il y a 7 années, pendant un Festival des Jeux qui avait drainé dix mille joueurs venus de 37 pays de la planète, permis à 1250 scrabbleurs de s'affronter, à 600 bridgeurs de
surenchérir, aux Africains de l'awalé de découvrir les subtilités du go, aux taroteurs de faire rouler les dés du Backgammon et à toutes les générations de se confronter en une gigantesque foire
d'empoigne dans les règles de l'art. C'est une vraie ville éphémère de province qui se constitue, une ville de 10 000 habitants où seuls les joueurs peuvent s'établir, qui possède ses codes
et ses habitudes, ses vainqueurs et ses perdants, ses drames et ses joies, son fair-play et ses tricheurs. Depuis 1987, pendant une semaine, Cannes devient la capitale incontournable des amateurs
de jeux, des classés aux débutants, jeunes, vieux, hommes, femmes, ils viennent tous par milliers afin de se frotter aux meilleurs et de mesurer leur niveau. Ils dorment en jouant et se
nourrissent des aspirations les plus étranges, sous perfusion d'un alchimiste pervers qui leur aurait inoculé le vice du jeu, les vertus du dérisoire.
25 000 m2 de stands, de moquettes, de salles aménagées avec des tables et des chaises, et du matin à tard dans la nuit, cette foule d'yeux impatients, de mains avides, de cette sueur qui sourd
quand le moment décisif du choix intervient, de ces gestes frénétiques qui rythment l'existence du joueur et le coupent de la réalité. Le joueur est un être qui vit sur une autre planète, perdu
dans les arcanes de l'initiation et qui se reconnaît une famille composée, s'invente des histoires et brave la destinée des mortels en tentant de lire les signes du ciel. Il espère arracher des
bribes d'immortalité aux jours qui s'écoulent, cherche toujours à transformer l'échec en un cheminement vers la perfection et quand il se campe au-dessus des lois, qu'il est le meilleur, le
vainqueur, alors il sent approcher la défaite et s'apprête à subir les affres de l'angoisse et du renoncement. Par un cruel paradoxe, c'est dans l'accession aux sommets des arts du jeu que les
grands se perdent et se laissent emporter dans les nuits glacées de la déraison. Bobby Fisher, génie absolu, en est un exemple, capable des coups les plus improbables, seul occidental qui a su à
dominer les Soviétiques en un demi-siècle d'opposition de style, vainqueur au finish d'un Boris Spassky à la dérive en 1972 à Reykjavik. Il entre en religion échiquéenne à l'âge de six ans,
quitte l'école à quatorze, devient le plus ignare des champions américains, étalant une inculture que seul son génie, les pièces de bois en main, pouvait compenser et, ceint de la couronne
mondiale, s'isole dans un silence austère et incompréhensible, se coupant du monde en un autisme définitif. Derrière la légende, on trouve le grand mystère de sa mère, cacique de l'école du Parti
à Moscou à la fin des années trente et de sa demi-sœur, Joan, née en URSS en 1938, jetant un voile trouble sur la victoire de l'Occident sur l'Orient.
Il en va ainsi pour tous ceux qui vivent leur vie dans les tournois, se transcendent pour une série, se dépassent pour un contrat et deviennent des géants parmi les hommes. La perfection d'une
stratégie, l'intuition sublime qui embrase, l'instinct définitif qui corrobore les éléments d'analyse, tout cela s'élabore dans la tension et la fureur de l'impuissance, entre l'imaginaire et le
réel.

/image%2F0621027%2F201309%2Fob_23d67b4562fbb6d524e0905baab360ae_headerblog.jpeg)